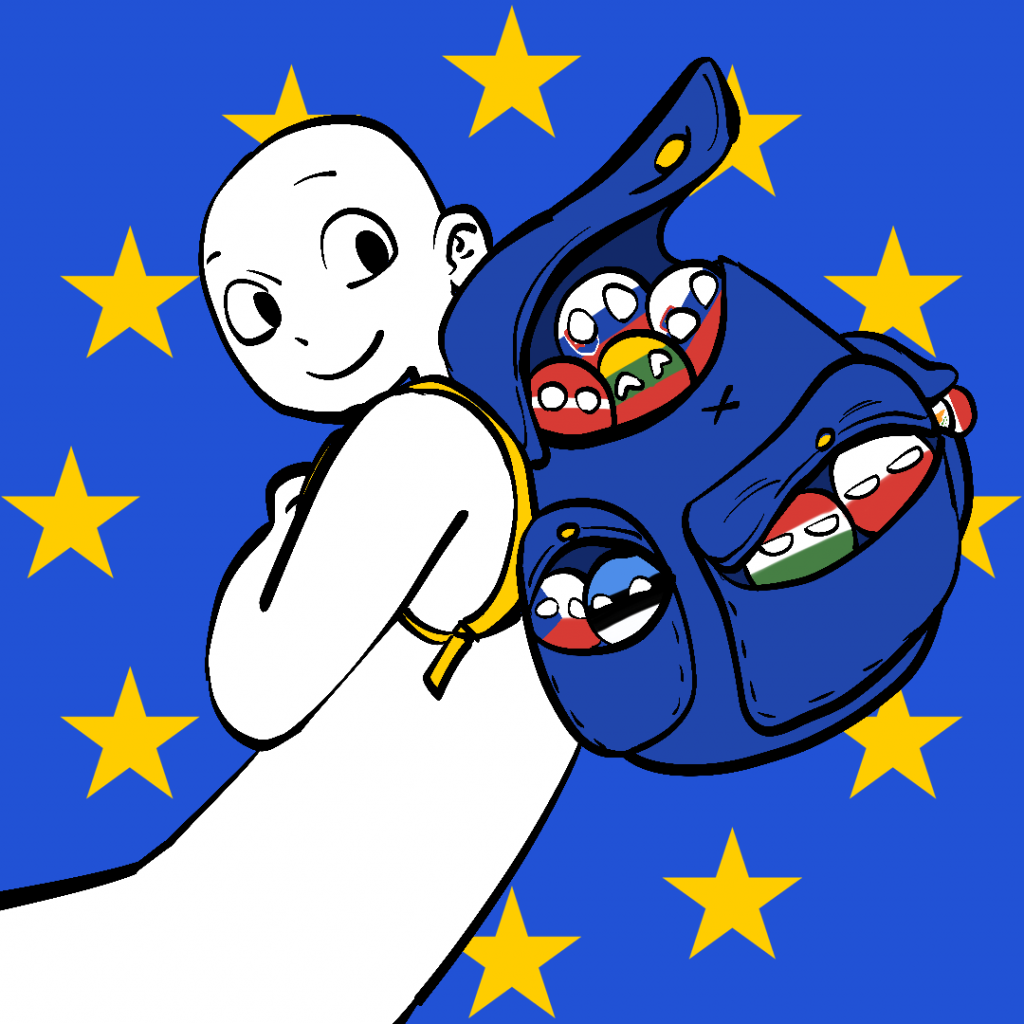
© Maison de l’Europe du Limousin, Doan Quoc-Tuan
La carte de l’Europe, suite à 7 élargissements successifs, est couverte de bleu étoilé. Pourtant, des blancs subsistent liés à deux situations : celle des pays qui, tout en étant associés, ne souhaitent pas intégrer l’Union : il s’agit de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande auxquels on peut adjoindre les 5 micro-Etats que sont les principautés d’Andorre, du Liechtenstein et de Monaco, la République de Saint-Marin et la Cité du Vatican ; par ailleurs, il y a la situation des pays candidats à l’adhésion.
Ces pays en attente d’un nouveau « grand élargissement » se situent sur le flanc oriental du continent européen. Au sud-est, un ensemble porté par la péninsule balkanique que depuis 1999, les institutions internationales (ONU, UE) et la presse, nomment les Balkans occidentaux. Outre la Croatie, déjà membre de l’UE, ils correspondent à la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, le Kosovo et l’Albanie. Ils forment un ensemble de 18 millions d’habitants soit 3,5 % de la population de l’UE, la Serbie avec 7,5 millions comptant pour 40 % du total. Aux Balkans occidentaux s’adjoignent la Turquie et ses 85 millions d’habitants et les anciennes républiques soviétiques d’Ukraine, de Moldavie et de Géorgie soit en cumulé plus de 44 millions d’habitants dont 38 pour la seule Ukraine[1].
Dans le processus d’adhésion, ces pays sont à des stades différents.
Les plus avancés ont vu leur candidature reconnue par l’UE et les négociations d’adhésion sont en cours. Ce sont : le Monténégro qui a acquis le statut de pays candidat en 2010 et est en négociation d’adhésion depuis 2012 ; la Serbie, statut de pays candidat en 2012, en négociation depuis 2014 ; la Macédoine du Nord, statut de pays candidat depuis 2005, en négociation depuis 2022 ; l’Albanie, statut de pays candidat 2014, en négociation depuis 2022 ; l’Ukraine et Moldavie, statut en 2022 et ouverture des négociations en juin 2024. Pour la Bosnie-Herzégovine, candidate officielle depuis décembre 2022 et la Géorgie depuis décembre 2023, les négociations d’adhésion n’ont pas encore débuté (le processus d’adhésion est même suspendu pour ce dernier pays).
Quant au Kosovo, s’il a déposé sa candidature en décembre 2022, il n’a pas encore obtenu le statut de candidat officiel.
Enfin, s’agissant de la Turquie, candidate depuis 1987, dotée du statut de pays candidat en décembre 1999, les négociations d’adhésion débutées en 2005, sont suspendues depuis 2018.
Outre l’hétérogénéité des parcours, cette chronologie révèle une panne de l’élargissement.
Depuis le début de la crise financière et économique, crise migratoire et Brexit aidant, on a assisté à un enlisement des candidatures balkaniques soumises à une « interminable » pré-adhésion génératrice de frustration voire de tension et de lassitude. Au reproche de réformes insuffisantes formulé par les Etats membres, les pays candidats ont répondu par un procès en manque de volonté réelle des 27 à les accueillir. Dans le même temps, des influences étrangères contraires aux intérêts européens n’ont cessé de croître dans la région : la Chine, la Russie et la Turquie sans oublier les Etats-Unis, avec des objectifs géostratégiques propres à chacun, ont multiplié les initiatives notamment culturelles.
En mai 2018, 15 ans après le Conseil de Thessalonique qui a rappelé que ces pays en rapprochement progressif avec l’Union sont des candidats potentiels à l’adhésion, un sommet UE/Balkans occidentaux s’est tenu à Sofia au cours duquel les dirigeants européens ont réaffirmé leur soutien à la « perspective européenne » de ces pays sans toutefois évoquer le calendrier d’adhésion. Pourtant, quelques jours plus tard, le Conseil a décidé, à la demande de la France et des Pays-Bas, de reporter la décision d’ouverture de négociations d’adhésion de l’Albanie et de la Macédoine du Nord à l’après-élections européennes 2019.
Celles-ci passées, la Commission a préconisé l’ouverture de ces négociations mais lors du Conseil européen d’octobre, sept heures de discussions n’ont pas permis de dégager un consensus et de sortir du dilemme : faire prévaloir l’hostilité à tout nouvel élargissement d’une partie de l’opinion publique singulièrement en Europe occidentale ou privilégier l’arrimage des Balkans occidentaux à l’Union afin d’empêcher qu’ils ne cèdent aux sirènes russes, chinoises ou turques.
Cependant, l’annonce, en mars 2020, de l’ouverture des négociations avec la Macédoine du Nord et avec l’Albanie, la réaffirmation deux mois plus tard du soutien de l’UE au processus d’élargissement et, à la fin de l’année, du renforcement de la coopération régionale montraient que les enjeux politiques l’emportaient. En février 2022, la guerre russe en Ukraine a fini de convaincre les dirigeants européens qu’il fallait accélérer le processus.
Pourtant, si l’obtention du statut de candidat par l’Ukraine et la Moldavie, en juin 2022 a été reçue avec l’espoir d’un déblocage, elle n’en a pas moins suscité beaucoup d’amertume et la date de 2030 pour l’intégration avancée par Charles Michel beaucoup de scepticisme.
L’élargissement est ainsi redevenu d’actualité.
Ce grand élargissement est comparable avec celui de 2004 par le nombre de pays concernés : 8 à venir en laissant de côté la Turquie et la Géorgie, contre 10 en 2004; par la superficie : 1,3 million km2 dont 603 000 pour l’Ukraine contre 738 000 dont 310 000 pour la seule Pologne ; par la population : 62,8 millions d’habitants dont un peu plus de 43 pour l’Ukraine (avant la guerre) contre 72,5 millions en 2004 dont 37 pour la seule Pologne.
Mais cet élargissement diffère de celui de 2004.
Il doit prendre en compte des situations politiques nationales instables dans un environnement régional difficile (litiges territoriaux, affrontements mémoriels) et un état de préparation des pays moindre qu’en 2004 et surtout beaucoup plus inégal entre eux.
Le Monténégro avec 33 chapitres ouverts sur 35 est le plus avancé mais il connaît une instabilité politique. La Serbie malgré l’ouverture de 25 chapitres inquiète par son attitude pro russe et ses rapports conflictuels avec le Kosovo et la Bosnie. La Macédoine du Nord, longtemps bloquée par la Grèce et la Bulgarie, n’a pu entamer les négociations qu’en juillet 2022 en même temps que l’Albanie, l’Union ayant lié les 2 candidatures. La Bosnie-Herzégovine, ayant répondu aux priorités de l’UE, les négociations ont débuté en mars 2024. L’adhésion du Kosovo bute sur l’absence de normalisation des rapports avec la Serbie. L’Ukraine malgré un niveau de corruption très élevé mais en raison de la détermination des dirigeants à installer un Etat de droit, bénéficie d’une procédure expresse. Et en décembre 2023, l’UE a accepté d’ouvrir les négociations ainsi qu’avec la Moldavie dont la candidature est liée. Face à une telle diversité, pour arrimer solidement tous les pays candidats à l’UE, l’idée d’une adhésion graduelle, par étapes comme Etat membre associé, fait son chemin.
Autre différence avec l’élargissement de 2004, la portée géopolitique. En 2004, l’Union réalisait une extension sans borner géographiquement le projet européen. Avec l’élargissement à venir la construction européenne touche aux limites géographiques du continent. Le projet européen se trouve en quelque sorte « territorialisé ». Mais cette clarification des limites dans un contexte de guerre en Ukraine et de menace en Moldavie en modifie la nature : en plus des dossiers économiques, l’Union se doit de prendre en charge les aspects géostratégiques : défense, frontières, approvisionnement énergétique. Comme l’a déclaré le Conseil européen lors du sommet de Grenade en octobre 2023 : « L’élargissement est un investissement géopolitique dans la paix, la sécurité et la prospérité. (…) ».
L’impératif d’un élargissement rapide constitue pour l’Union un défi majeur pour lequel, selon le Conseil, elle « doit jeter les bases et les réformes internes nécessaires. ».
Dans un rapport remis en septembre 2023, un groupe de douze experts franco-allemands indépendants mandaté par le Conseil pour proposer une feuille de route, formule quatre recommandations[2]:
- avant tout élargissement, protéger l’Etat de droit et le faire respecter dans les Etats membres actuels et futurs en simplifiant les procédures pour sanctionner des manquements ;
- augmenter le budget nominal mais aussi en pourcentage du PIB des pays afin d’accroître la capacité d’agir de l’Union ;
- avant le prochain élargissement, dépasser la règle de l’unanimité au Conseil au profit du vote à la majorité qualifiée dans tous les domaines de décision : élargissement, État de droit, politique étrangère et de défense, politique budgétaire et fiscale ;
- réaliser une intégration différenciée avec mise en place de 4 cercles de pays : le cercle restreint des coalitions existantes d’Etats volontaires (zone euro, Schengen) ; le cercle de référence de l’Union européenne comprenant tous les Etats membres liés par le traité, ses valeurs et ses objectifs de solidarité ; un premier cercle externe comprenant les pays associés intégrés au marché intérieur (EEE, Suisse et Royaume-Uni) ; un second cercle externe, sans intégration, sans accès au marché unique et construit sur les convergences géopolitique et politique, type Communauté politique européenne, l’instance de coopération lancée en 2022.
Début octobre 2023, les chefs d’Etat et de gouvernement ont lancé les discussions sur le prochain élargissement. Certains pays comme les Etats baltes, souhaitent une accession rapide quand d’autres, comme la France et l’Allemagne, lient élargissement et réforme de l’Union. En mars 2024, la Commission européenne a publié un rapport dans lequel elle « recommande que les futurs Etats membres s’intègrent de manière progressive par le biais d’un processus qui serait aussi réversible ».
[1] En 2021, le pays comptait 44 millions d’habitants.
[2] « Naviguer en haute mer : réforme et élargissement de l’UE au XXIe siècle », www.diplmatie.gouv.fr
